Introduction
On parle aujourd'hui en France de « l'école de la confiance » (Ministère de l'Education Nationale [MEN], 2017) et du « développement de l'esprit critique » (MEN, 2022) comme si ces finalités éducatives devaient être abordées séparément, par exemple d'une part par la psychologie, d'autre part par l'épistémologie ou la didactique. Dans cette communication, nous proposons une autre piste de réflexion qui permet de dépasser ce clivage.
En épistémologie, on nomme « responsabilité épistémique » tout ce qui, dans cette responsabilité, concerne la formation des croyances dont le but est d'acquérir des connaissances. Et c'est le propre de l'éthique intellectuelle de s'interroger sur cette dimension de la responsabilité car « l'éthique intellectuelle porte sur les devoirs ou sur les vertus propres à la capacité de former des croyances et d'obtenir des connaissances en général » (Engel, 2019, p.21). Mais qu'en est-il en didactique ?
Elements théoriques, aperçu méthodologique et résultats
En théorie de l'action conjointe en didactique (TACD), on désigne par « dévolution » (Glossaire de la TACD, 2022, en ligne) : « le fait que le professeur donne à l'élève une responsabilité d'apprendre, et plus précisément d'apprendre quelque chose d'une certaine façon et le fait que l'élève assume cette responsabilité. ». Mais qu'en est-il de la responsabilité épistémique ? Par quels dispositifs didactiques peut-on rendre l'élève plus responsable de la formation de ses croyances ? Pas seulement dans le cadre de la leçon mais de manière plus globale et durable dans son environnement quotidien ? En philosophie deux conceptions s'affrontent : l'éthique évidentialiste (e.g. Engel, 2019) et « l' éthique des vertus » (Pouivet, 2020). Pour la première, on ne doit former de croyances nouvelles que sur la base de preuves évidentes (principe dit « de Clifford »). Pour la seconde la responsabilité épistémique ne saurait être comprise sans faire appel aux vertus que doit exercer celui qui apprend. C'est en exerçant des vertus telles que la confiance, la persévérance, l'honnêteté que celui qui apprend peut exercer une réelle responsabilité dans la formation de ses croyances.
Dans le cadre d'un webinaire consacré à l'Antropologie Didactique des Activités Corporelles (ADPC), nous avons fait intervenir et interrogé depuis 2020 plusieurs formateur·rice·s intervenant dans des contextes variés : les soins infirmiers, la plongée sous-marine, l'éducation physique et sportive, ainsi que des Compagnons du Devoir.
Un des résultats est le suivant : l'étude des interventions permet de souligner l'importance de l'exercice des vertus et de la complexité de la relation contrat didactique-milieu didactique, dans l'émergence d'une responsabilité épistémique.
Rappelons qu'en TACD, le contrat didactique « peut être vu également comme un système d'attentes et d'attributions d'attentes qui relie le professeur et les élèves, et sur lequel les transactants s'appuient pour interpréter les actions d'autrui. Il peut être aussi conçu comme un système de règles du jeu. On peut également le considérer comme un système de normes. Enfin, le contrat didactique peut s'appréhender comme un système d'habitudes » (Glossaire TACD, 2022, en ligne) relatives à ce qu'il y a à faire. Corollairement, le milieu didactique est vu en TACD comme étant ce avec quoi faire ce qu'il y a à faire pour avancer dans la résolution d'un problème dont l'enquête est dévoluée à l'élève. Le milieu désigne ainsi la structure symbolique du problème que l'élève a la responsabilité de travailler. La situation se présente au départ sous la forme d'un ensemble de signes épars qui ne font pas sens, en général, pour l'élève : le milieu de la situation pose problème. En d'autres termes, il y a résistance du milieu. Sur la base du déjà-là du contrat didactique et dans ses transactions avec le professeur, l'élève travaille ces signes épars et les organise progressivement en un système cohérent de significations, sensibles et épistémiques, qui constituent le savoir nouveau à apprendre » (Glossaire TACD, 2022, en ligne).
Dans le cadre de cette communication, nous présenterons dans cette perspective en TACD les points communs qui émergent des présentations et discussions avec les formateur·rice·s afin de produire une analyse comparée des obstacles épistémologiques et didactiques qui s'opposent à l'apprentissage d'une telle responsabilité. Nous approfondirons ainsi l'étude des conditions logiques de la dévolution de cette responsabilité.
Références bibliographiques
Engel, P. (2019). Les vices du savoir. Agone
Glossaire de la TACD (2022). Repéré à : http://tacd.espe-bretagne.fr/glossaire/
Pouivet, R, (2020). L'Ethique intellectuelle. Vrin
Ministère de l'Education nationale (2017). 12 changements pour bâtir l'École de la confiance. Repéré à : https://www.gouvernement.fr/12-changements-pour-batir-l-ecole-de-la-confiance
Ministère de l'Education nationale (2022). Développement de l'esprit critique chez les élèves. Repéré à : https://www.education.gouv.fr/developpement-de-l-esprit-critique-chez-les-eleves-341106
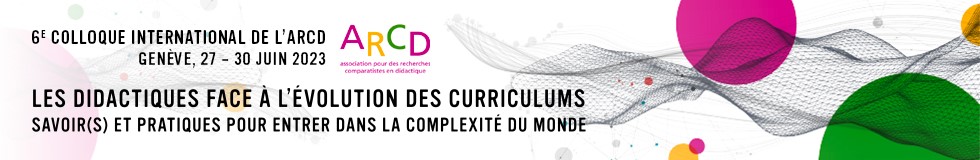
 PDF version
PDF version
